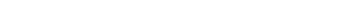⌘ A lire aussi ce mois-ci
⌘ En images

⌘ Du même auteur
Il n'y a pas d'autres articles du même auteur
Des progrès futurs de l’Esprit humain

Pour Condorcet comme pour Rousseau, l'Homme est perfectible. Son essence consiste à s'extraire de la Nature. Les techniques et sciences peuvent nous y aider. Ce texte raisonne particulièrement à notre époque, où il est question de transhumanisme.
Si l’homme peut prédire, avec une assurance presque entière, les phénomènes dont il connaît les lois ; si lors même qu’elles lui sont inconnues, il peut, d’après l’expérience du passé, prévoir avec une grande probabilité les événements de l’avenir ; pourquoi regarderait-on comme une entreprise chimérique, celle de tracer, avec quelque vraisemblance, le tableau des destinées futures de l’espèce humaine d’après les résultats de son histoire. Le seul fondement de croyance dans les sciences naturelles est cette idée que les lois générales, connues ou ignorées, qui règlent les phénomènes de l’Univers, sont nécessaires et constantes ; et par quelle raison ce principe serait-il moins vrai pour le développement des facultés intellectuelles et morales de l’homme que pour les autres opérations de la nature ? Enfin, puisque des opinions formées d’après l’expérience du passé, sur des objets du même ordre, sont la seule règle de la conduite des hommes les plus sages, pourquoi interdirait-on au philosophe d’appuyer ses conjectures sur cette même base, pourvu qu’il ne leur attribue pas une certitude supérieure à celle qui peut naître du nombre, de la constance, de l’exactitude des observations ?
Nos espérances, sur l’état à venir de l’espèce humaine, peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l’inégalité entre les nations, les progrès de l’égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l’homme. Toutes les nations doivent-elles se rapprocher un jour de l’état de civilisation où sont parvenus les peuples les plus éclairés, les plus libres, les plus affranchis de préjugés, tels que les Français et les Anglo-Américains ? Cette distance immense qui sépare ces peuples de la servitude des nations soumises à des rois, de la barbarie des peuplades africaines, de l’ignorance des Sauvages, doit-elle peu-à-peu s’évanouir ?
Y a-t-il, sur le globe, des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de la liberté, à ne jamais exercer leur raison ?
Cette différence de lumières, de moyens ou de richesses, observée jusqu’à présent chez tous les peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d’eux ; cette inégalité, que les premiers progrès de la société ont augmentée et pour ainsi dire produite, tient-elle à la civilisation même, ou aux imperfections actuelles de l’art social ? Doit-elle continuellement s’affaiblir pour faire place à cette égalité de fait, dernier but de l’art social, qui, diminuant même les effets de la différence naturelle des facultés, ne laisse plus subsister qu’une inégalité utile à l’intérêt de tous, parce qu’elle favorisera les progrès de la civilisation, de l’instruction et de l’industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement ? En un mot, les hommes approcheront-ils de cet état, où tous auront les lumières nécessaires pour se conduire d’après leur propre raison dans les affaires communes de la vie, et la maintenir exempte de préjugés ; pour bien connaître leurs droits et les exercer d’après leur opinion et leur conscience ; où tous pourront, par le développement de leurs facultés, obtenir des moyens sûrs de pourvoir à leurs besoins ; où enfin, la stupidité et la misère ne seront plus que des accidents, et non l’état habituel d’une portion de la société ?
Enfin, l’espèce humaine doit-elle s’améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts, et par une conséquence nécessaire, dans les moyens de bien-être particulier et de prospérité commune ; soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique ; soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l’intensité ou dirigent l’emploi de ces facultés, ou même de celui de l’organisation naturelle.
En répondant à ces trois questions, nous trouverons, dans l’expérience du passé, dans l’observation des progrès que les sciences, que la civilisation ont faits jusqu’ici, dans l’analyse de la marche de l’esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la nature n’a mis aucun terme à nos espérances.
Nos espérances, sur l’état à venir de l’espèce humaine, peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l’inégalité entre les nations, les progrès de l’égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l’homme. Toutes les nations doivent-elles se rapprocher un jour de l’état de civilisation où sont parvenus les peuples les plus éclairés, les plus libres, les plus affranchis de préjugés, tels que les Français et les Anglo-Américains ? Cette distance immense qui sépare ces peuples de la servitude des nations soumises à des rois, de la barbarie des peuplades africaines, de l’ignorance des Sauvages, doit-elle peu-à-peu s’évanouir ?
Y a-t-il, sur le globe, des contrées dont la nature ait condamné les habitants à ne jamais jouir de la liberté, à ne jamais exercer leur raison ?
Cette différence de lumières, de moyens ou de richesses, observée jusqu’à présent chez tous les peuples civilisés, entre les différentes classes qui composent chacun d’eux ; cette inégalité, que les premiers progrès de la société ont augmentée et pour ainsi dire produite, tient-elle à la civilisation même, ou aux imperfections actuelles de l’art social ? Doit-elle continuellement s’affaiblir pour faire place à cette égalité de fait, dernier but de l’art social, qui, diminuant même les effets de la différence naturelle des facultés, ne laisse plus subsister qu’une inégalité utile à l’intérêt de tous, parce qu’elle favorisera les progrès de la civilisation, de l’instruction et de l’industrie, sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement ? En un mot, les hommes approcheront-ils de cet état, où tous auront les lumières nécessaires pour se conduire d’après leur propre raison dans les affaires communes de la vie, et la maintenir exempte de préjugés ; pour bien connaître leurs droits et les exercer d’après leur opinion et leur conscience ; où tous pourront, par le développement de leurs facultés, obtenir des moyens sûrs de pourvoir à leurs besoins ; où enfin, la stupidité et la misère ne seront plus que des accidents, et non l’état habituel d’une portion de la société ?
Enfin, l’espèce humaine doit-elle s’améliorer, soit par de nouvelles découvertes dans les sciences et dans les arts, et par une conséquence nécessaire, dans les moyens de bien-être particulier et de prospérité commune ; soit par des progrès dans les principes de conduite et dans la morale pratique ; soit enfin par le perfectionnement réel des facultés intellectuelles, morales et physiques, qui peut être également la suite, ou de celui des instruments qui augmentent l’intensité ou dirigent l’emploi de ces facultés, ou même de celui de l’organisation naturelle.
En répondant à ces trois questions, nous trouverons, dans l’expérience du passé, dans l’observation des progrès que les sciences, que la civilisation ont faits jusqu’ici, dans l’analyse de la marche de l’esprit humain et du développement de ses facultés, les motifs les plus forts de croire que la nature n’a mis aucun terme à nos espérances.
Condorcet (Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de), Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1re édition en 1795 Paris : Masson et fils, 1822 p. 262/265.
Le 13-10-2016
Laisser un commentaire