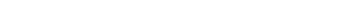Le droit à la paresse

Un poète grec du temps de Cicéron, Antiparos, chantait ainsi l'invention du moulin à eau (pour la mouture du grain) : il allait émanciper les femmes esclaves et ramener l'âge d'or :
« Épargnez le bras qui fait tourner la meule, ô meunières, et dormez paisiblement ! Que le coq vous avertisse en vain qu'il fait jour ! Dao a imposé aux nymphes le travail des esclaves et les voilà qui sautillent allégrement sur la roue et voilà que l'essieu ébranlé roule avec ses rais, faisant tourner la pesante pierre roulante : Vivons de la vie de nos pères et oisifs, réjouissons-nous des dons que la déesse accorde. »
Hélas ! Les loisirs que le poète païen annonçait ne sont pas venus ; la passion aveugle, perverse et homicide du travail transforme la machine libératrice en instrument d'asservissement des hommes libres : sa productivité les appauvrit.
Une bonne ouvrière ne fait avec le fuseau que cinq mailles à la minute, certains métiers circulaires à tricoter en font trente mille dans le même temps. Chaque minute à la machine équivaut donc à cent heures de travail de l'ouvrière ; ou bien chaque minute de travail de la machine délivre à l'ouvrière dix jours de repos. Ce qui est vrai pour l'industrie du tricotage est plus ou moins vrai pour toutes les industries renouvelées par la mécanique moderne. Mais que voyons-nous ? À mesure que la machine se perfectionne et abat le travail de l'homme avec une rapidité et une précision sans cesse croissantes, l'ouvrier, au lieu de prolonger son repos d'autant, redouble d'ardeur, comme s'il voulait rivaliser avec la machine. Oh ! concurrence absurde et meurtrière !
Pour que la concurrence de l'homme et de la machine prît libre carrière, les prolétaires ont aboli les sages lois qui limitaient le travail des artisans des antiques corporations ; ils ont supprimé les jours fériés[1]. Parce que les producteurs d'alors ne travaillaient que cinq jours sur sept, croient-ils donc, ainsi que le racontent les économistes menteurs, qu'ils ne vivaient que d'air et d'eau fraîche ? Allons donc ! Ils avaient des loisirs pour goûter les joies de la terre, pour faire l'amour et rigoler ; pour banqueter joyeusement en l'honneur du réjouissant dieu de la Fainéantise. La morose Angleterre, encagottée dans le protestantisme, se nommait alors la « joyeuse Angleterre » (Merry England). Rabelais, Quevedo, Cervantès, les auteurs inconnus des romans picaresques, nous font venir l’eau à la bouche avec leurs peintures de ces monumentales ripailles dont on se régalait alors entre deux batailles et deux dévastations, et dans lesquelles tout « allait par escuelles ». Jordaens et l'école flamande les ont écrites sur leurs toiles réjouissantes. Sublimes estomacs gargantuesques, qu'êtes-vous devenus ? Sublimes cerveaux qui encercliez chez toute la pensée humaine, qu'êtes-vous devenus? Nous sommes bien amoindris et bien dégénérés. La vache enragée, la pomme de terre, le vin fuchsiné et le schnaps prussien savamment combinés avec le travail forcé ont débilité nos corps et rapetissé nos esprits. Et c'est alors que l'homme rétrécit son estomac et que la machine élargit sa productivité, c'est alors que les économistes nous prêchent la théorie malthusienne, la religion de l'abstinence et le dogme du travail ? Mais il faudrait leur arracher la langue et la jeter aux chiens.
Parce que la classe ouvrière, avec sa bonne foi simpliste, s'est laissé endoctriner, parce que, avec son impétuosité native, elle s'est précipitée en aveugle dans le travail et l'abstinence, la classe capitaliste s'est trouvée condamnée à la paresse et à la jouissance forcée, à l'improductivité et à la surconsommation. Mais, si le surtravail de l'ouvrier meurtrit sa chair et tenaille ses nerfs, il est aussi fécond en douleurs pour le bourgeois.
L'abstinence à laquelle se condamne la classe productive oblige les bourgeois à se consacrer à la surconsommation des produits qu'elle manufacture désordonnément. Au début de la production capitaliste, il y a un ou deux siècles de cela, le bourgeois était un homme rangé, de mœurs raisonnables et paisibles ; il se contentait de sa femme ou à peu près ; il ne buvait qu'à sa soif et ne mangeait qu'à sa faim. Il laissait aux courtisans et aux courtisanes les nobles vertus de la vie débauchée. Aujourd'hui, il n'est fils de parvenu qui ne se croie tenu de développer la prostitution et de mercurialiser son corps pour donner un but au labeur que s'imposent les ouvriers des mines de mercure ; il n'est bourgeois qui ne s'empiffre de chapons truffés et de Lafite navigué, pour encourager les éleveurs de La Flèche et les vignerons du Bordelais. À ce métier, l'organisme se délabre rapidement, les cheveux tombent, les dents se déchaussent, le tronc se déforme, le ventre s'entripaille, la respiration s'embarrasse, les mouvements s'alourdissent, les articulations s'ankylosent, les phalanges se nouent. D'autres, trop malingres pour supporter les fatigues de la débauche, mais dotés de la bosse du prudhommisme, dessèchent leur cervelle comme les Garnier de l'économie politique, les Acollas de la philosophie juridique, à élucubrer de gros livres soporifiques pour occuper les loisirs des compositeurs et des imprimeurs.
Les femmes du monde vivent une vie de martyr. Pour essayer et faire valoir les toilettes féeriques que les couturières se tuent à bâtir, du soir au matin elles font la navette d'une robe dans une autre ; pendant des heures, elles livrent leur tête creuse aux artistes capillaires qui, à tout prix, veulent assouvir leur passion pour l'échafaudage des faux chignons. Sanglées dans leurs corsets, à l'étroit dans leurs bottines, décolletées à faire rougir un sapeur, elles tournoient des nuits entières dans leurs bals de charité afin de ramasser quelques sous pour le pauvre monde. Saintes âmes !
Pour remplir sa double fonction sociale de non producteur et de surconsommateur, le bourgeois dut non seulement violenter ses goûts modestes, perdre ses habitudes laborieuses d'il y a deux siècles et se livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilitiques, mais encore soustraire au travail productif une masse énorme d'hommes afin de se procurer des aides. (…)
Une fois accroupie dans la paresse absolue et démoralisée par la jouissance forcée, la bourgeoisie, malgré le mal qu'elle en eut, s'accommoda de son nouveau genre de vie. Avec horreur elle envisagea tout changement. La vue des misérables conditions d'existence acceptées avec résignation par la classe ouvrière et celle de la dégradation organique engendrée par la passion dépravée du travail augmentaient encore sa répulsion pour toute imposition de travail et pour toute restriction de jouissances. (…)
Donc, en se serrant le ventre, la classe ouvrière a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie condamnée à la surconsommation.
Pour être soulagée dans son pénible travail, la bourgeoisie a retiré de la classe ouvrière une masse d'hommes de beaucoup supérieure à celle qui restait consacrée à la production utile, et l'a condamnée à son tour à l'improductivité et à la surconsommation. Mais ce troupeau de bouches inutiles, malgré sa voracité insatiable, ne suffit pas à consommer toutes les marchandises que les ouvriers, abrutis par le dogme du travail, produisent comme des maniaques, sans vouloir les consommer, et sans même songer si l'on trouvera des gens pour les consommer.
En présence de cette double folie des travailleurs, de se tuer de surtravail et de végéter dans l'abstinence, le grand problème de la production capitaliste n'est plus de trouver des producteurs et de décupler leurs forces, mais de découvrir des consommateurs, d'exciter leurs appétits et de leur créer des besoins factices. Puisque les ouvriers européens, grelottant de froid et de faim, refusent de porter les étoffes qu'ils tissent, de boire les vins qu'ils récoltent, les pauvres fabricants, ainsi que des dératés, doivent courir aux antipodes chercher qui les portera et qui les boira : ce sont des centaines de millions et de milliards que l'Europe exporte tous les ans, aux quatre coins du monde, à des peuplades qui n'en ont que faire[2]. Mais les continents explorés ne sont plus assez vastes, il faut des pays vierges. Les fabricants de l'Europe rêvent nuit et jour de l'Afrique, du lac saharien, du chemin de fer du Soudan ; avec anxiété, ils suivent les progrès des Livingstone, des Stanley, des Du Chaillu, des de Brazza ; bouche béante, ils écoutent les histoires mirobolantes de ces courageux voyageurs. Que de merveilles inconnues renferme le « continent noir » ! Des champs sont plantés de dents d'éléphant, des fleuves d'huile de coco charrient des paillettes d'or, des millions de culs noirs, nus comme la face de Dufaure ou de Girardin, attendent les cotonnades pour apprendre la décence, des bouteilles de schnaps et des bibles pour connaître les vertus de la civilisation.
Mais tout est impuissant : bourgeois qui s'empiffrent, classe domestique qui dépasse la classe productive, nations étrangères et barbares que l'on engorge de marchandises européennes ; rien, rien ne peut arriver à écouler les montagnes de produits qui s'entassent plus hautes et plus énormes que les pyramides d'Égypte : la productivité des ouvriers européens défie toute consommation, tout gaspillage. Les fabricants, affolés, ne savent plus où donner de la tête ils ne peuvent plus trouver la matière première pour satisfaire la passion désordonnée, dépravée, de leurs ouvriers pour le travail. Dans nos départements lainiers, on effiloche les chiffons souillés et à demi pourris, on en fait des draps dits de renaissance, qui durent ce que durent les promesses électorales ; à Lyon, au lieu de laisser à la fibre soyeuse sa simplicité et sa souplesse naturelle, on la surcharge de sels minéraux qui, en lui ajoutant du poids, la rendent friable et de peu d'usage. Tous nos produits sont adultérés pour en faciliter l'écoulement et en abréger l'existence. Notre époque sera appelée l'âge de la falsification, comme les premières époques de l'humanité ont reçu les noms d'âge de pierre, d'âge de bronze, du caractère de leur production. Des ignorants accusent de fraude nos pieux industriels, tandis qu'en réalité la pensée qui les anime est de fournir du travail aux ouvriers, qui ne peuvent se résigner à vivre les bras croisés. Ces falsifications, qui ont pour unique mobile un sentiment humanitaire, mais qui rapportent de superbes profits aux fabricants qui les pratiquent, si elles sont désastreuses pour la qualité des marchandises, si elles sont une source intarissable de gaspillage du travail humain, prouvent la philanthropique ingéniosité des bourgeois et l'horrible perversion des ouvriers qui, pour assouvir leur vice de travail, obligent les industriels à étouffer les cris de leur conscience et à violer même les lois de l'honnêteté commerciale.
Et cependant, en dépit de la surproduction de marchandises, en dépit des falsifications industrielles, les ouvriers encombrent le marché innombrablement, implorant : du travail ! du travail ! Leur surabondance devrait les obliger à refréner leur passion ; au contraire, elle la porte au paroxysme. Qu'une chance de travail se présente, ils se ruent dessus ; alors c'est douze, quatorze heures qu'ils réclament pour en avoir leur saoul, et le lendemain les voilà de nouveau rejetés sur le pavé, sans plus rien pour alimenter leur vice. Tous les ans, dans toutes les industries, des chômages reviennent avec la régularité des saisons. Au surtravail meurtrier pour l'organisme succède le repos absolu, perdant des deux et quatre mois ; et plus de travail, plus de pitance. Puisque le vice du travail est diaboliquement chevillé dans le cœur des ouvriers ; puisque ses exigences étouffent tous les autres instincts de la nature ; puisque la quantité de travail requise par la société est forcément limitée par la consommation et par l'abondance de la matière première, pourquoi dévorer en six mois le travail de toute l'année ? Pourquoi ne pas le distribuer uniformément sur les douze mois et forcer tout ouvrier à se contenter de six ou de cinq heures par jour, pendant l'année, au lieu de prendre des indigestions de douze heures pendant six mois ? Assurés de leur part quotidienne de travail, les ouvriers ne se jalouseront plus, ne se battront plus pour s'arracher le travail des mains et le pain de la bouche ; alors, non épuisés de corps et d'esprit, ils commenceront à pratiquer les vertus de la paresse. (…)
[1] Sous l'Ancien Régime, les lois de l'Église garantissaient au travailleur 90 jours de repos (52 dimanches et 38 jours fériés) pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C'était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l'irréligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la Révolution, dès quelle fut maîtresse, elle abolit les jours fériés et remplaça la semaine de sept Jours par celle de dix. Elle affranchit les ouvriers du joug de l'Église pour mieux les soumettre au joug du travail.
La haine contre les jours fériés n'apparaît que lorsque la moderne bourgeoisie industrielle et commerçante prend corps, entre les XVe et XVIe siècles. Henri IV demanda leur réduction au pape ; il refusa parce que « l'une des hérésies qui courent aujourd’hui, est touchant les fêtes » (lettre du cardinal d'Ossat). Mais, en 1666, Péréfixe, archevêque de Paris, en supprima 17 dans son diocèse. Le protestantisme, qui était la religion chrétienne, accommodée aux nouveaux besoins industriels et commerciaux de la bourgeoisie, fut moins soucieux du repos populaire ; il détrôna au ciel les saints pour abolir sur terre leurs fêtes.
La réforme religieuse et la libre pensée philosophique n'étaient que des prétextes qui permirent à la bourgeoisie jésuite et rapace d'escamoter les jours de fête du populaire. (…)
[2] Deux exemples : le gouvernement anglais, pour complaire aux pays indiens qui, malgré les famines périodiques désolant le pays, s'entêtent à cultiver le pavot au lieu du riz ou du blé, a dû entreprendre des guerres sanglantes, afin d'imposer au gouvernement chinois la libre introduction de l'opium indien. Les sauvages de la Polynésie malgré la mortalité qui en fut la conséquence, durent se vêtir et se saouler à l'anglaise, pour consommer les produits des distilleries de l'Écosse et des ateliers de tissage de Manchester.