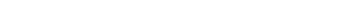André Comte-Sponville : "Toute époque est tragique"

Dirigeant : Vous consacrez votre dernier ouvrage[1] à la notion de tragique. Traversons-nous aujourd’hui une époque que l’on peut qualifier de tragique ?
André Comte-Sponville : Le tragique, c’est la prise en compte inconsolée de ce qu’il y a d’effrayant, de décevant ou de désespérant dans la condition humaine. Ce n’est pas le tout de notre vie (il y a aussi des moments de plaisir, de joie, de bonheur), mais c’en est une dimension importante. En ce sens, toute époque est tragique : aucune n’échappe à l’effroi ou à la déception, encore moins à la finitude et à la mort ! C’est en quoi Eschyle ou Sophocle restent actuels, tout autant que Shakespeare ou Racine. Mais ce tragique essentiel prend bien sûr des formes différentes, en fonction des aléas ou des nécessités de l’histoire. Toute époque est tragique, mais toutes ne le sont pas de la même façon.Qu’y a-t-il de plus effrayant dans la nôtre ? Sans doute le péril écologique ou environnemental. C’est comme une nouvelle finitude : non plus celle de l’individu (la mort), mais celle de la planète. La croissance, comme processus économique, est indéfinie : on peut toujours ajouter de la richesse à la richesse. On le fait depuis 10 000 ans (la Révolution néolithique), et d’autant plus en économie capitaliste, qui transforme la richesse en source d’enrichissement (c’est ce qu’on appelle un capital : de la richesse créatrice de richesse). Mais nous comprenons de mieux en mieux que ce processus indéfini de croissance économique se heurte aux limites, elles strictement finies, de l’écologie, qui sont les limites de la planète. Notre mode actuel de développement est insoutenable : il nous entraîne dans le mur. Il faut donc renoncer au développement. C’est ce qu’on appelle la décroissance. Ou bien trouver un autre mode de croissance, moins vorace en énergies fossiles, en eau douce et en terres arables. C’est ce qu’on appelle le développement durable, facile à nommer, difficile à faire ! Effroi donc, mais aussi déception.On pouvait croire que le progrès économique allait résoudre tous les problèmes, et l’on constate de plus en plus que ce n’est pas vrai : que la croissance économique n’est pas une panacée, et qu’elle échoue à résoudre les problèmes civilisationnels auxquels nous sommes confrontés. De ce point de vue, le retour du fondamentalisme religieux, spécialement dans le monde musulman, a aussi quelque chose de décevant ou d’effrayant. Dans ma jeunesse, on avait le sentiment que les Lumières avaient gagné. Et voilà que l’obscurantisme revient, avec ses fanatiques, ses terroristes, ses massacres… Déception, pour les rationalistes, et effroi, pour tous : c’est le tragique même !
D. On vous définit volontiers comme libéral. Certains, à la gauche de la gauche, attribuent précisément la responsabilité de ce qui nous arrive aujourd’hui au libéralisme et à ses excès. Quelle est votre position à ce sujet ?
A.C.-S. : Je ne suis pas économiste. Mais il me semble que la crise que nous connaissons s’explique moins par le libéralisme que par les excès conjugués et opposés de l’État providence et de l’ultralibéralisme. Le premier pousse à un endettement irresponsable et intenable, qui finit par soumettre les États aux marchés financiers (soumission que la gauche après coup a beau jeu de dénoncer, surtout quand elle est dans l’opposition, mais dont elle est pour une part responsable, lorsqu’elle est au pouvoir). Le second, l’ultralibéralisme, prétend absurdement que la liberté du marché suffit à tout, ce qui est évidemment faux. Le marché ne vaut, par définition, que pour les marchandises, autrement dit que pour ce qui se vend et s’achète. Si vous pensez que tout se vend, que tout s’achète, soyez ultralibéral : plus besoin d’État, le marché suffit à tout ! Si, à l’inverse, vous pensez comme moi qu’il y a des choses qui ne sont pas à vendre (la vie, la liberté, la dignité, la justice, le monde), il n’est pas question de les soumettre au marché : nous avons besoin des États pour assurer leur protection. On a fini par comprendre, y compris en France et y compris à gauche, que les États n’étaient pas très bons pour créer de la richesse : le marché et les entreprises le font plus et mieux. C’est pourquoi Lionel Jospin a privatisé toute une partie de ce qu’Alain Juppé n’avait pas réussi à privatiser. À mon sens, ils ont eu raison l’un et l’autre. Mais il serait temps de comprendre, y compris à droite, que le marché et les entreprises ne sont pas très bons pour créer de la justice : seuls les États ont une chance d’y parvenir à peu près. On ne va quand même pas retomber perpétuellement dans la vieille schizophrénie des années 1980, où être de droite c’était être pour le marché, contre l’État, et où être de gauche c’était être pour l’État, contre le marché ! Les plus lucides, à droite comme à gauche, ont fini par comprendre qu’il n’y pas à choisir entre l’État et le marché : on a besoin du marché pour tout ce qui est à vendre, et c’est très important ; on a besoin de l’État pour tout ce qui n’est pas à vendre, et c’est évidemment essentiel.
D. : Selon vous, le libéralisme doit-il être moralisé ?
A.C.-S. : Parlons plutôt de capitalisme que de libéralisme ! Le libéralisme est une doctrine. Le capitalisme, un système impersonnel, objectif, sans sujet ni fin. A ce titre, il n’est ni moral ni immoral, mais foncièrement amoral, en donnant au préfixe a — son sens purement privatif. J’entends par là que la morale est sans pertinence aucune pour décrire ou expliquer quelque processus économique que ce soit. C’est vrai en particulier du capitalisme : il ne fonctionne pas à la vertu, à la générosité ou au désintéressement, mais tout au contraire à l’intérêt, personnel ou familial. Disons le mot : le capitalisme fonctionne à l’égoïsme. Mais cela ne le condamne pas, bien au contraire ! D’abord parce que l’égoïsme fait partie des droits de l’homme, ensuite parce qu’il est la principale force motrice dans l’être humain.Le capitalisme fonctionne à l’égoïsme, c’est pourquoi il fonctionne si fort.Mais cela, qui explique son efficience économique, marque aussi ses limites. L’égoïsme n’a jamais suffi à faire une civilisation, ni même une société qui soit humainement acceptable. Il faut donc imposer au fonctionnement amoral du marché un certain nombre de limites non marchandes et non marchandables, qui sont à la charge des États. C’est ce qu’on appelle le modèle social-démocrate, et c’est celui dans lequel je me reconnais. Encore faut-il l’adapter au monde d’aujourd’hui. C’est pourquoi je me définis comme libéral de gauche ou social-libéral. Qu’est-ce que le social-libéralisme ? C’est la social-démocratie confrontée aux contraintes de la mondialisation, et qui l’assume. Cela vaut mieux que l’archaïsme, l’aveuglement ou la mauvaise foi ! Faut-il moraliser le capitalisme ? Tout dépend du sens qu’on donne à cette expression ! Si l’on entend par là qu’il faudrait rendre le capitalisme intrinsèquement moral, de telle sorte qu’il ne fonctionne plus à l’intérêt personnel ou familial, mais à la vertu, à la générosité ou au désintéressement, c’est un vœu pieux, une pure illusion, qui nous vouerait, si nous la prenions au sérieux, à l’impuissance. En revanche, si l’on entend par « moraliser le capitalisme » le fait de lui imposer, de l’extérieur, des limites non marchandes et non marchandables, alors non seulement on peut le faire, non seulement on doit le faire, mais on le fait depuis 150 ans ! Quand on interdit le travail des enfants, quand instaure l’école laïque, gratuite et obligatoire, quand on garantit le droit de grève et les libertés syndicales, quand on crée les congés payés, la retraite et la Sécurité sociale, on moralise le capitalisme, et c’est évidemment tant mieux. On a fait d’immenses progrès, depuis le XIXe siècle. D’autres restent à faire : le combat continue ! Le progrès dépend moins de la vertu des uns et des autres que de la politique.
[1] André Comte-Sponville, Du tragique au matérialisme (et retour), PUF, 2015, 728 p., 29 €.
 1 commentaire
1 commentaire