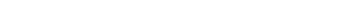Cynthia Fleury : « Assumer ce en quoi l’on croit et ne pas renier ses valeurs »

Dirigeant : Pourquoi vous être intéressée au courage ?
Cynthia Fleury : Tout est parti d’un constat de malaise général. Les gens n’arrivent plus à suivre les préceptes de notre société. On leur réclame d’être hyper performants et collectifs, pour, au final, ne les juger que sur leurs résultats individuels. L’accélération étant continue, pour rester dans le coup, chacun se suradapte et désavoue ses principes. On espère passer entre les gouttes en faisant le dos rond. Cette attitude ne conduit qu’à perdre son âme et entraîne souffrance, dépression, suicide… car, sur le long terme, pour un individu comme pour une collectivité, il n’existe qu’une seule manière de se protéger : assumer ce en quoi l’on croit et ne pas renier ses valeurs. Or, pour assurer cette vigilance quotidienne, il faut du courage. Je souhaitais donc rappeler à quel point le courage est un facteur de protection et de régulation essentiel. D’autant plus important que, contrairement à ce que pensent beaucoup, la démocratie n’est pas un acquis fonctionnant seul. Elle réclame un combat quotidien en ce qu’elle fournit non des droits, mais uniquement les conditions propices à l’existence de ces droits.
D. : Votre constat est valable partout ?
C. F. : Principalement dans les vieilles démocraties : France, Grande-Bretagne, États-Unis, où les classes moyennes qui sont le cœur vivant de toute démocratie traversent des temps difficiles et… perdent courage. L’enjeu est de refaire du courage une valeur mimétique.
D. : Et les chefs d’entreprise auraient un rôle à jouer dans cette « mission » ?
C. F. : Depuis un an et demi, à la demande de leurs dirigeants, je parcours les entreprises pour parler du courage, « outil de leadership ». Qu’il y ait du courage dans la prise de décision, on le sait. Le dirigeant est un pionnier qui possède le sens du risque - et non son goût ! -, mais il est par ailleurs un gouvernant dont le rôle est de réguler. Le courage est le premier outil de gouvernance. Mais pour que le courage existe dans une entreprise, il faut que les employés s’y sentent autorisés. Que la parole, même discordante, soit libérée. J’ai vu trop d’entreprises où la boîte à idées ne servait qu’à stigmatiser tout ce qui était proposé, entraînant un pourrissement de la capacité d’inventer. Or, le dirigeant doit promouvoir l’esprit d’innovation, quitte à se tromper. L’actuelle évaluation par les seuls résultats conduit à assimiler toute recherche qui n’aboutit pas à un échec. Privées de leur dynamique d’anticipation, nombre d’entreprises se retrouvent enfermées dans le court terme, contraintes aux seuls processus de réaction et de rattrapage.
D. : Mais pourquoi devrait-on attendre des entreprises qu’elles montrent l’exemple ?
C. F. : L’entreprise est le cœur vivant de la société. Si elle fonctionne dans un cadre démocratique, elle n’est pas elle-même une véritable démocratie, plutôt un laboratoire, un lieu d’avant-garde. Et ça, c’est passionnant ! Parce que quand un patron le décide, il peut parvenir, en trois ans, à une forme d’appropriation de nouveaux comportements sociaux et professionnels, chose absolument impossible ailleurs : État ou administration...
D. : N’est-ce pas pourtant là, précisément le rôle de l’État ?
C. F. : En France, historiquement, oui. Dans les pays anglo-saxons ou libéraux, ce rôle relève plutôt de la société civile. Chez nous, depuis une vingtaine d’années, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est devenue une réalité et les entreprises des moteurs, comme on le constate sur des questions telles que la discrimination, la parité ou l’environnement.
D. : Vous parlez d’un contrat de confiance à restaurer entre entreprise et citoyens…
C. F. : L’entreprise a longtemps été synonyme d’ascension sociale et d’égalité des chances, mais de plus en plus, à l’image de la société tout entière, elle se bloque : plafonds de verre, mobilité contrainte, redistribution inéquitable et abandon de la mission formatrice qui fait qu’à 28 ans des jeunes sont obligés de rester chez papa-maman… L’entreprise qui créait de l’autonomisation crée de la dépendance. Il faut travailler à changer cela.
D. : Certains s’y sont mis ?
C. F. : Un certain nombre de dirigeants pariant sur un capitalisme plus équitable s’investissent, fédèrent, agissent. A la fois pragmatiques et progressistes, ils repensent la croissance sans négliger ses aspects éthiques. Connectés au collectif, ils savent que l’innovation sociale est une force. A une époque où tout évolue si vite, ils assurent par exemple l’indispensable formation de leurs employés. Car si l’actuelle formation continue constitue un business considérable, elle est improductive. Aux États-Unis, les quarantenaires retournent depuis toujours sur les bancs de l’école. Il faudra y venir.

La Fin du courage, Cynthia Fleury, Fayard, 2010
 2 commentaires
2 commentaires